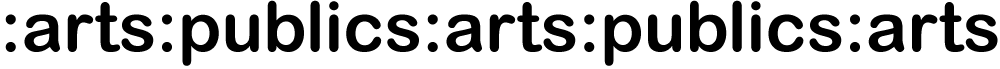Je lis des romans japonais
Je lis des romans japonais, parce que dans ces romans, parler de fleurs, c’est-à-dire parler de pique-niques sous les cerisiers en fleurs, parler des saisons, de la manière dont, peut-être, les plantes se renouvellent, fanent et meurent, dans ces romans, c’est tout à fait normal, ça n’étonne personne. Il n’y a pas de petit rictus. Les fleurs de cerisier font partie des préoccupations des personnages ; iels sont sincères, pur·es, lorsqu’iels décident d’aller se promener du côté de la rivière parce que c’est la saison des grenouilles. Et ça me fait du bien. C’est comme avec Annie Dillard, mais elle, elle s’ennoblit de la filiation de la nature writing ; ça lui permet d’écrire à propos d’un arbre, à l’automne, dont les feuilles se mettent à flamboyer sur un parking, et ça lui permet d’écrire à propos de tous les insectes de la rivière. Quelque part, elle accentue la logique des personnages de romans japonais, qui, de leur côté, ritualisent la fréquentation des végétaux – il existe des saisons pour telle fleur, des moments pour tel lieu –, puisqu’elle va tous les jours au bord de la rivière, examiner plantes et insectes, têtards et morceaux putréfiés de bois, avant de revenir dans sa cabane pour décrire tout ce qu’elle a vu – ce qu’elle ennoblit de la filiation que j’ai dit, et d’une dense fréquentation intertextuelle. Est-ce que cela manque de naturel ? je ne crois pas. Annie Dillard a grandi, comme moi, au milieu d’une culture où parler de fleurs est d’emblée suspect. Je le savais bien, cet été, devant mon talus. Peut-être même que cet attrait des fleurs – beaucoup plus fort que l’attrait des mal-nommées « mauvaises herbes » – est ancré en moi depuis un héritage culturel un peu kitsch, qu’une autre partie de cet héritage me rend honteux. Je ne sais pas. Je lis aussi des romans japonais parce qu’Ito Ogawa écrit des choses tellement douces, lorsque ses personnages se nourrissent. Taniguchi aussi, dans ses mangas. Les personnages de romans japonais mangent beaucoup, et ça n’a rien d’obscène ; c’est aussi délicat que, disons, Huysmans lorsqu’il écrit des tas de choses sur les odeurs ; mais Huysmans tartine un certain nombre de paragraphes pour ce faire, et son personnage, peut-être, ne se nourrit pas – en réalité, je suis mauvaise langue, il se nourrit peut-être, j’ai oublié – en réalité, dans Là-bas, il ne manque jamais de détailler la composition du menu, simple et copieux, que partagent ses quatre personnages. Mais ce n’est pas pareil. Ses personnages se délectent de telle viande, de tel pâté, d’abord parce qu’iels en sont pas tous·tes issu·es de la même classe sociale, et que les invité·es ramènent à leurs hôtes une nourriture trop chère pour elleux. Il y a une délectation toute spéciale, je crois, dans ce geste d’offrir des viandes chères, que la maîtresse de maison prépare avec brio. Ce n’est pas exactement la même chose dans les romans japonais — même si les préoccupations sociales ne sont pas tout à fait absentes de l’arrière-pensée des personnages – je pense à Poppo, qui ne mange de l’anguille qu’invitée par le Baron, dans ce restaurant luxueux de Kamakura. Non, ce que je veux dire, c’est qu’il n’y a rien d’indélicat, dans les romans japonais, lorsqu’un personnage mange, et qu’il en éprouve beaucoup de satisfaction. Ou de tristesse. Toute la gamme des émotions est contenue dans les repas, qui de plus, ont l’air très bons. Maryse Condé, qui est française, a consacré un livre autobiographique à son rapport à la cuisine – elle est, dit-elle, excellente cuisinière –, mais ce n’est pas ça non plus. Ça sent le procédé – ce qui n’a rien de désagréable, mais aucun procédé n’accompagne Rinco lorsqu’elle cuisine une soupe de potiron, ou un sandwich. Je ne m’amuse pas à construire des théories, et j’aimerais qu’on ne m’en fasse pas grief ; quelquefois, seulement, j’aimerais être japonaise pour écrire des fleurs, tranquillement, et de la nourriture, tranquillement.